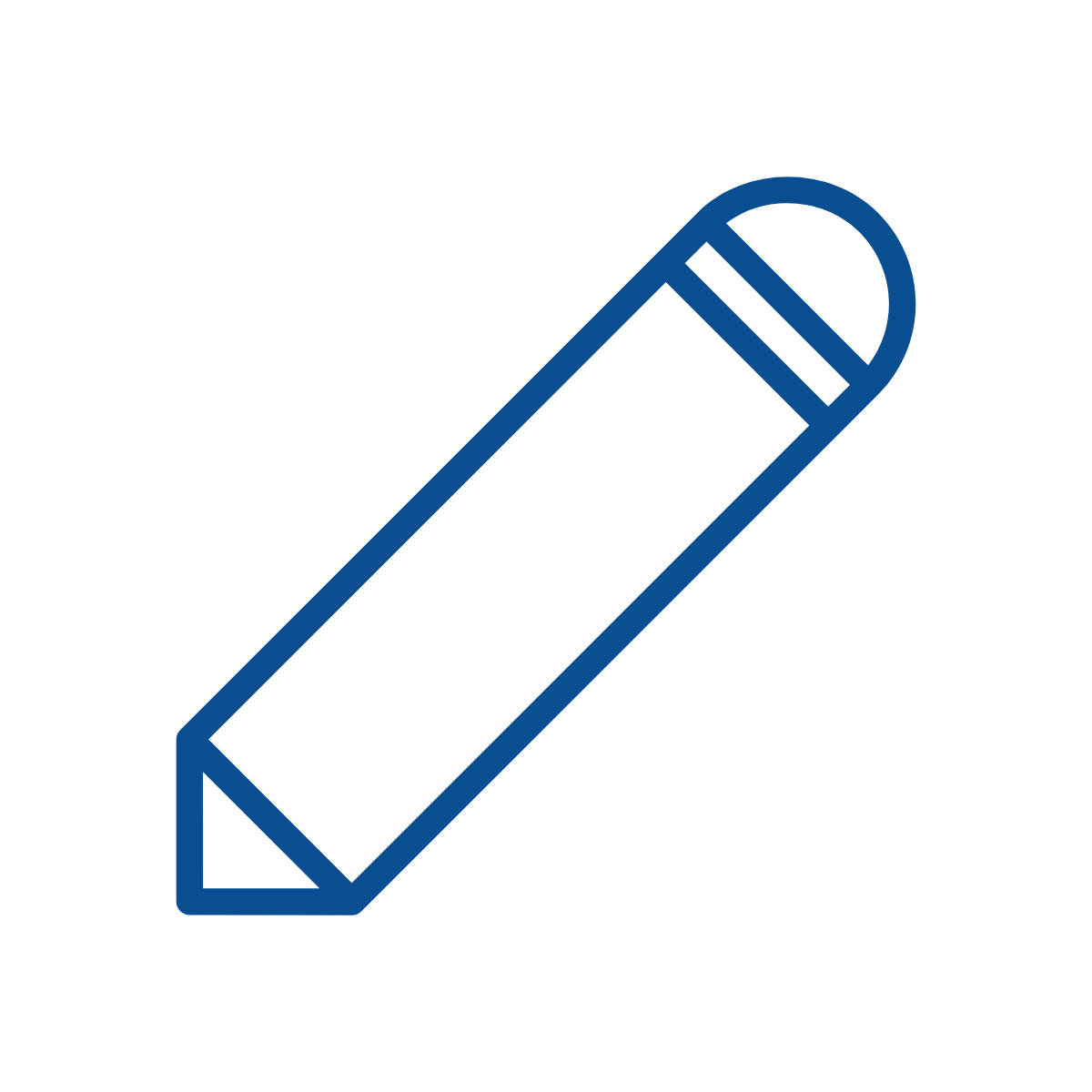Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Julien Cabay - De la musique au droit d’auteur, de la propriété intellectuelle à l’IA
Il peut y avoir des motivations très diverses qui permettent de comprendre pourquoi une personne décide à un moment de se lancer dans la réalisation d’un doctorat. Parfois, elles se prolongent dans une carrière académique.…

Quel est ton parcours académique et quels ont été tes principaux thèmes de recherche des dernières années ?
Je suis diplômé de notre Faculté en 2009 (Master en droit privé) et de la KULeuven en 2011 (Master complémentaire en propriété intellectuelle). J’ai commencé ma thèse de doctorat dans le cadre d’un mandat d’aspirant au FNRS (2010-2014) et je l’ai terminée en qualité d’assisant au Centre de droit privé de l’ULB (2014-2016). Ma thèse, intitulée L’objet de la protection du droit d’auteur – Contribution à l’étude de la liberté de création[1], est en quelque sorte le fruit d’une histoire familiale. En effet, je suis issu d’une famille de musiciens (je suis un modeste amateur, mais mon père et mon frère sont jazzmen professionnels) et en m’intéressant de plus près à la matière du droit d’auteur (avant même de me spécialiser en master complémentaire, durant mes études à l’ULB, j’étais jobiste au service juridique de la SABAM), j’ai rapidement compris le hiatus qui existait entre la pratique artistique et son régime juridique. Aussi dans ma thèse, j’ai tenté de systématiser la jurisprudence en droit d’auteur pour permettre de dégager des espaces de liberté créative, en m’appuyant spécialement sur le concept de « juste équilibre » entre droits fondamentaux, qui était alors naissant dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en droit d’auteur (et qui a depuis lors révélé son potentiel). En germes, cette thèse contenait tous les éléments qui allaient définir mes lignes de recherche future : théorie et pratique de la propriété intellectuelle, droit comparé, approche interdisciplinaire et approche critique de l’innovation. Et si je continue à explorer le sujet précis de ma thèse[2], j’arpente également les nombreuses pistes de recherches qu’elle a dégagé.
Après ma défense de thèse, tout est allé très vite. Moi, je m’imaginais poursuivre ma recherche à l’étranger. J’avais fait un Eramus de 6 mois à Rome pendant mon Master et j’avais été Visiting Scholar pendant une année à la Columbia Law School à New York pendant ma thèse. Aussi, j’aspirais donc à repartir (ce que j’ai d’aillleurs fait en 2018 comme Global Policy Fellow à l’Instituto Tecnologia e Sociedade à Rio de Janeiro, quoique pour une très courte période). Mais quelques mois à peine après ma défense en 2016, alors que j’avais commencé comme chercheur postdoc au FNRS à l’ULB (et ce jusqu’en 2020) j’étais en même temps engagé (et demeure à ce jour) à l’Université de Liège comme chargé de cours dans le master complémentaire en droit européen de la concurrence et de la propriété intellectuelle. J’avais aussi la même année commencé à enseigner la propriété intellectuelle à l’ULB dans le cadre du nouveau LL.M. in international business law. Et l’année suivante, en 2017, j’étais engagé dans le cadre d’une chaire en droit des créations intellectuelles et des innovations à l’ULB. C’est donc surtout dans ce cadre que je me suis investi.
Je pense que dans le cadre de cette chaire, mon principal accomplissement est la création (avec Andrée Puttemans) et le développement du JurisLab[3] (voy. infra), installé dans le Fab Lab de l’ULB[4], où je mène des recherches et développe des projets d’enseignement interdisciplinaires avec mes collègues des autres Facultés des sciences et techniques. Le JurisLab est un environnement riche qui m’a permis de concevoir bien des projets. Si je devais en choisir deux, je citerais respectivement le projet TRIPI TRAPI que je déploie dans le cadre de mon cours d’approche interdisciplinaire de la propriété intellectuelle, d’une part, et le projet IPSAM, d’autre part (voy. infra). Ce sont deux projets qui me tiennent à cœur et dont les résultats obtenus sont au-delà de toutes mes espérances.
Outre des collaborations interfacultaires, j’essaye également d’inscrire le JurisLab dans des collaborations interuniversitaires en Belgique et au-delà. A côté de l’Université de Liège, j’entretiens des liens privilégiés avec la KULeuven, l’Université de Strasbourg et l’Université de Genève (dans lesquelles je suis professeur invité ou chercheur affilié) sur lesquelles je m’appuie. Actuellement, j’investis aussi pas mal d’énergie dans la mise sur pied d’une collaboration avec l’Université de Waseda.
Est-ce qu’il y a un projet qui vient de se terminer et qui t’a particulièrement motivé ?
Mon projet IPSAM[5] était financé par un ARC consolidation qui vient d’arriver à échéance au mois de mai 2025. Ce projet m’a permis de diriger comme promoteur principal la thèse de Thomas Vandamme, une thèse en sciences de l’ingénieur et technologies (avec mon collègue Olivier Debeir comme co-promoteur de l’Ecole polytechnique)[6]. Avec Thomas, nous avons étudié des outils d’intelligence artificielle (IA) censés permettre d’identifier des similitudes entre des marques. Dans le cadre de ce projet interdisciplinaire, nous sommes parvenus à démontrer que ces outils étaient incapables d’intégrer les règles gouvernant l’examen du risque de confusion en droit des marques. Nous avons même pu montrer que certains outils mis en production étaient affectés par des biais et des erreurs de conception d’une certaine gravité[7]. Les technologies que nous avons examinées sont « closed sources » et nous avons donc dû les étudier en « black box ». Pour ce faire, nous avons développé des méthodes tout à fait inédites, tant pour ce qui concerne l’acquisition des données nécessaires à la recherche que pour l’étude des outils proprement dit. Ce projet a donc permis de contribuer de manière tout à fait unique tant à la recherche dans le domaine de la propriété intellectuelle que de la régulation de l’IA.
Nous avons beaucoup diffusé les résultats de ce projet à travers une série de conférences[8]. En retour, d’autres collègues se sont mis à les diffuser également. Il y a quelques jours, un professeur d’Oxford (qui siégeait dans le jury de thèse de Thomas) nous annoncé qu’il venait de présenter nos résultats à l’un des grands messes du droit des marques, devant près de 1000 praticiens du domaine, et que l’on devait s’attendre à être très sollicités vu l’intérêt suscité par nos recherches. A vrai dire, la quantité de données générées, les résultats engrangés et les découvertes que nous avons réalisées dans le cadre de ce projet dépassent de loin nos ambitions initiales. Aussi, nous continuons à les exploiter et espérons pouvoir le faire pendant quelques années encore. Thomas est actuellement postdoc au JurisLab et avec un peu de chances, je parviendrai à le maintenir dans mon équipe pendant quelques années encore. Les demandes de financement devant permettre la poursuite de la recherche ont en tout cas été déposées. On croise les doigts.
L’IA s’est inscrite dans tes thèmes de recherche. Il s’agit d’un thème interdisciplinaire, en particulier pour allier le droit, la science et la technologie. Comment est-ce que cette caractéristique influence ta recherche de financement ?
Tous les chercheurs en propriété intellectuelle étudient l’IA. Le thème s’impose à nous par la nature même de ces technologies, dont le développement est notamment conditionné par le cadre juridique en droit d’auteur (spécialement, l’entraînement machine, singulièrement des IA génératives, repose largement sur des exceptions au droit d’auteur, le « Text and Data Mining – TDM » dans l’UE[9] et le « Fair Use » aux USA[10]). Dans le même temps, tout le monde se focalise sur les mêmes questions, alors qu’il y a tant à faire.
Dans ce contexte, j’ai la chance d’avoir une approche singulière car mon angle d’approche, à savoir l’impact de l’IA sur l’analyse des similitudes en propriété intellectuelle, est assez inédit. Cela s’explique par le fait que l’étude des similitudes en propriété intellectuelle est traditionnellement délaissée par la doctrine classique (je pense que c’est en raison de son côté très casuistique). Nous sommes vraiment très peu à étudier cela en théorie de la propriété intellectuelle. Or moi, cela me fascine. C’était d’ailleurs au cœur de ma thèse de doctorat. Aussi, je peux aisément déposer des projets de recherche dont l’originalité est généralement soulignée, d’autant que je peux m’appuyer sur de très fortes collaborations interdisciplinaires avec les sciences et techniques ce qui est fort apprécié par les bailleurs de fonds.
Le revers de la médaille, c’est que même certains experts du domaine ne comprennent pas bien ce que l’on fait, simplement parce qu’ils n’ont pas connaissance de l’état de leur propre droit ou de l’état de l’art. Et lorsque l’on ajoute la dimension interdisciplinaire, c’est plus complexe encore. Certains retours d’évaluateurs (que ce soit pour des publications ou des demandes de financement) nous ont fait comprendre qu’il nous faut être très pédagogique dans nos explications. Il n’est donc pas si évident de lever des fonds pour ce type de recherche.
Est-ce que tu pourrais nous parler du lien que tu établis entre enseignement et recherche ?
Comme je le disais, l’étude des similitudes en propriété intellectuelle est au cœur de mes recherches. Or, c’est assez complexe d’un point de vue conceptuel, notamment parce que les contraintes techniques qui pèsent sur la création ont un impact déterminant sur l’analyse juridique[11]. En d’autres termes, une certaine compréhension technique (au sens large, la technique pouvant toucher à des questions relatives à la résistance des matériaux, comme aux règles harmoniques de tel genre musical) de l’objet de propriété intellectuelle est indispensable pour la bonne appréhension des règles. Fort de ce constat, j’ai imaginé le projet TRIPI TRAPI[12] dans lequel les étudiants, en groupe interdisciplinaire juristes et ingénieurs, fabriquent, grâce aux outils de fabrication numérique du Fab Lab, des objets présentant un certain degré de similitude (technique et juridique) avec la chaise iconique Tripp Trapp.
Au départ de cet objet qu’ils créent, ils découvrent les règles du droit de la propriété intellectuelle et apprennent à comprendre leur fonctionnement. Je qualifie cette forme d’enseignement « Object-Made Learning », qui va un pas plus loin encore qu’une forme bien connue d’enseignement que l’on qualifie d’ « Object-Based Learning ». Je pense que ces formes d’enseignement sont particulièrement prometteuses en droit et j’essaye donc de les déployer dans mes différents cours. Il s’agit toutefois de formes d’enseignement extrêmement chronophages et qui ne sont pas du tout théorisées dans le domaine juridique. Aussi, ces expériences ont une sorte d’effet boomerang puisqu’elles me permettent d’alimenter une nouvelle thématique de recherche centrée sur l’innovation pédagogique, qui m’amène vers les sciences de l’éducation. Je vais d’ailleurs dans quelques jours à Portsmouth présenter, pour la deuxième année consécutive, mes expériences pédagogiques à la conférence annuelle du European Intellectual Property Teachers’ Network[13].
Quel est le principal défi lorsqu’on réalise des recherches interdisciplinaires sur le thème de la propriété intellectuelle ?
Le défi tient au degré d’interdisciplinarité de la question de recherche et aux moyens dont on dispose pour la traiter. Je peux illustrer ceci en comparant une partie de ma recherche doctorale avec une partie de la recherche dans le projet IPSAM. Dans la première, j’ai travaillé sans relâche pendant 18 mois pour récolter et analyser de manière systématique environ 400 décisions de justice, en extrayant les données à la main et en utilisant un tableur Excel afin d’établir des corrélations entre elles. Les résultats de cette recherche étaient précieux, mais essentiellement juridiques. Dans la seconde, avec Thomas en quelques semaines nous avions créé une base de données de plus de 8.000 décisions (grâce à des techniques de web scrapping) dont nous avions extrait automatiquement les informations qui nous intéressait, et qui allaient nous servir de base à une expérience dans le cadre de laquelle des millions de données seraient traitées et analysées automatiquement à la lumière de ces informations, une fois encore en quelques semaines. Ici aussi, les résultats de cette seconde recherche étaient riches sur le plan juridique, mais ici ils étaient nourris en plus d’informations statistiques. Évidemment, pour cette seconde recherche je disposais de moyens complémentaires, à la fois financiers (budget de fonctionnement), humains (deux chercheurs au lieu d’un) et surtout, techniques (les compétences d’un ingénieur). Si j’avais disposé des mêmes moyens pour la première recherche, j’aurais certainement pu aller bien plus loin, par exemple en élargissant mon échantillon jurisprudentiel ou en fournissant par ailleurs une étude statistique[14]. A travers cet exemple, on voit bien que la question et les objectifs de la recherche doivent être définis en fonction des moyens à disposition. Cela paraît évident et ce n’est pas propre à la propriété intellectuelle. Mais comme le droit de la propriété intellectuelle est intrinsèquement interdisciplinaire du fait de son objet même, à moins de choisir des questions de recherche très restreintes et d’une pertinence assez limitée, la recherche dans ce domaine impose la recherche de financements d’une certaine ampleur. Et on le sait tous, trouver des financements, c’est un vrai défi.
Quels conseils pourrais-tu donner à d’autres chercheur.e.s qui ont doivent faire face au rejet par exemple d’une publication dans une revue scientifique et qui sont au tout début de leur carrière ?
Je n’ai personnellement pas eu d’expérience de refus de publication quand j’étais jeune chercheur. Si ce n’est une fois, où un éditeur (d’une revue non scientifique) m’avait demandé de modifier certains passage de mon introduction pour ne pas « froisser » son lectorat. A la réflexion, j’avais accepté de modifier une partie, sous réserve d’une phrase qu’il me demandait d’effacer. J’ai refusé et justifié le maintien de cette phrase. L’éditeur a finalement accepté de me suivre. Je pense qu’il était (et ce sont ces mots de l’époque) « excessivement prudent »…
Plus récemment par contre, et pour la première fois de ma carrière, une des publications avec Thomas tirées du projet IPSAM a été refusée. Nous avions soumis dans le journal « interdisciplinaire » qui nous paraissait le plus pertinent et qui disposait du plus haut facteur d’impact (il y en avait deux possibles). Nous avons été très surpris quand nous avons reçus les « peer reviews » assez négatifs. Notre surprise tenait surtout au fait que les critiques des « peer reviewers » n'étaient aucunement justifiées sur le fond. Ils nous critiquaient pour ne pas avoir adopté une autre approche que celle qui était la nôtre, estimant que cette autre approche aurait été préférable. Le problème, c’est que ce qu’il nous proposait de faire était une approche de pure ingénierie qui n’avait aucun intérêt par rapport à la question de recherche et qu’au contraire, c’était précisément notre approche interdisciplinaire qui avait permis de fournir des résultats inédits. Malgré nos réponses aux « peer reviewers », le plus critique a maintenu son opposition et l’éditeur a refusé de nous publier. Comme il était manifeste que les peer reviewers étaient ingénieurs (et non juristes) et que nous avions déjà pu constater avec Thomas une approche beaucoup plus favorable à l’interdisciplinaire chez les juristes, nous avons resoumis la publication sans changer une ligne dans l’autre revue « interdisciplinaire » avec le même facteur d’impact, dont je savais qu’elle était plutôt estampillée juridique. Et là, c’est tout l’inverse qui s’est produit puisque les « peer reviews » étaient dithyrambiques et notre article a pu être publié.
De ces deux expériences, mon conseil aux jeunes chercheurs serait donc le suivant. Les critiques, lorsqu’elles sont fondées, vous renseignent sur le fond de votre travail. Les critiques, lorsqu’elles ne sont pas fondées, peuvent vous renseigner sur la forme, car elles témoignent peut-être de que vous n’avez pas bien communiqué votre message. Il convient de tenir compte de ces deux types de critiques. Mais si à la relecture il vous paraît que le fond comme la forme sont de qualité, alors le problème se situe chez l’éditeur. Dans ce cas, changez simplement d’éditeur. Après tout, c’est vous l’expert.
Pourrais-tu nous parler du JurisLab, son importance et les raisons qui ont poussé à sa création ?
Le JurisLab est une unité de recherches du Centre de droit privé de l’ULB, situé dans le Fab Lab de l’ULB sur le nouveau campus Usquare. La création du JurisLab est la résultante de plusieurs éléments. Tout d’abord, il existait déjà dans les faits, au sein de l’Unité de droit économique du Centre, une équipe de chercheurs dans les domaines du droit de la propriété intellectuelle, des données, de la consommation et des technologies qui gravitait autour d’Andrée Puttemans (à l’époque directrice de l’Unité). Ensuite, lorsque j’ai été nommé dans la chaire en droit des créations intellectuelles et des innovations, je me suis retrouvé rapidement à participer aux activités du Fab Lab (alors situé en Faculté d’architecture) avec des collègues d’autres Facultés. Je pense que cela s’est imposé comme une évidence, pour eux comme pour moi, que j’étais à ma place dans ce contexte. Aussi lorsque l’université a envisagé de créer un Fab Lab à l’échelle universitaire sur le site des casernes (le futur campus Usquare), j’ai été associé au projet, avec la possibilité d’avoir des bureaux à destination des juristes, au beau milieu d’un atelier de fabrication numérique.
Avec Andrée Puttemans, nous avons donc proposé au Centre de créer une nouvelle unité de recherches, constituée de l’équipe qui l’entourait alors, et de la délocaliser sur le campus Usquare. C’était en 2019. Depuis lors, j’en assure la direction et ai poussé son développement. Depuis sa création, deux thèses de doctorat ont déjà été défendues, deux autres le seront cette année académique, et nous avons obtenu un certain nombre de projets de recherche (Horizon Europe ; ARC ; FNRS ; FEE). De manière intéressante, il ressort des évaluations de ces projets de recherche que la dimension interdisciplinaire de l’environnement de recherche que constitue le JurisLab constitue un atout pour l’étude de nos matières. Cela s’explique d’ailleurs simplement. La meilleure manière d’apprendre une langue, c’est probablement d’être en immersion linguistique. Et la meilleure manière de comprendre le droit des créations et des innovations, c’est d’être immergé dans la technique. Quant à la meilleure manière de comprendre ce que sont le JurisLab et le Fab Lab, c’est pareil : il faut venir s’y immerger.
Pour en savoir plus :
- JurisLab : https://droit-prive.ulb.be/unite/jurislab/
- Fab Lab : https://fablab.ulb.be/
- IPSAM : https://droit-prive.ulb.be/ipsam-adressing-intellectual-property-relevant-similarities-in-images-through-algorithmic-decision-systems/
- TRIPI TRAPI : https://droit-prive.ulb.be/tripi-trapi/
[1] https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/228996/Holdings
[2] Voy. dernièrement J. Cabay, “La condition d’originalité en droit d’auteur : in abstracto, in concreto”, in B. Vanbrabant (sous la dir. de), Propriété intellectuelle et secrets d’affaire, Commission Université-Palais (CUP), vol. 230, Limal, Anthemis, 2024, pp. 8-58, https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/386661/Holdings
[3] https://droit-prive.ulb.be/unite/jurislab/
[4] https://fablab.ulb.be/
[5] https://droit-prive.ulb.be/ipsam-adressing-intellectual-property-relevant-similarities-in-images-through-algorithmic-decision-systems/
[6] T. Vandamme, Algorithmic Confusion: A Transversal Strudy of Computational Trade Mark Similarity, Doctoral Thesis in Engineering and Technology, ULB, 2025, 227 p., https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/390049/Holdings
[7] Voy. spéc. J. Cabay, T. Vandamme, O. Debeir, “Looking Through the Crack in the Black Box: A Comparative Case Law Benchmarking for Auditing AI-Powered Trade Mark Search Engines”, Computer Law & Security Review, 2025, 106167, https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/391089/Holdings ; T. Vandamme, J. Cabay, O. Debeir, “A Quantitative Evaluation of Trademark Search Engines’ Performances through Large-Scale Statistical Analysis”, in X., Proceedings of the Nineteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2023), June 19–23, 2023, Braga, Portugal, ACM, New York (NY, USA), 2023, pp. 343-350, https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/359739/Holdings
[8] Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Japon ; on a encore une intervention aux USA le mois prochain. Les slides (et certaines vidéos) de toutes nos conférences sont disponibles sur le site du projet et Di-fusion.
[9] Directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, JO L 130 du 17.5.2019, p. 92-125, Art. 4 ; Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JO L du 12.7.2024, Art. 53(1)(c).
[10] Les premières décisions à ce propos ont été prononcées récemment : https://ipkitten.blogspot.com/2025/06/northern-district-of-californias-busy.html
[11] Pour illustrer l’intrication des deux dimensions, voici un exemple concret. Pour bénéficier d’une protection par le droit des dessins et modèles, l’objet doit présenter un « caractère individuel », ce qui suppose de vérifier « si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public », tout en « [tenant] compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle » (Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, JO L 3 du 5.1.2002, p. 1-24, Art. 6). Or, suivant une jurisprudence constante, « (…) plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti (…) » (Trib. U.E., 12 mars 2014, Tubes Radiatori c. OHMI, T‑315/12, EU:T:2014:115, point 67). A travers cet exemple, on comprend bien l’impossibilité d’appliquer les règles du droit de la propriété intellectuelle sans une certaine compréhension technique.
[12] https://droit-prive.ulb.be/tripi-trapi/
[13] http://www.eiptn.eu/
[14] Dernièrement, nous avons justement organisé au JurisLab le « Book Launch » d’une collègue de l’Université de Notthingham qui vient de réaliser une étude de ce type avec un statisticien. Son travail montre bien le potentiel de ce type d’études interdisciplinaires, mais elle soulignait pareillement lors de ce book launch qu’ils n’auraient pas pu réaliser cette recherche sans disposer de moyens importants.