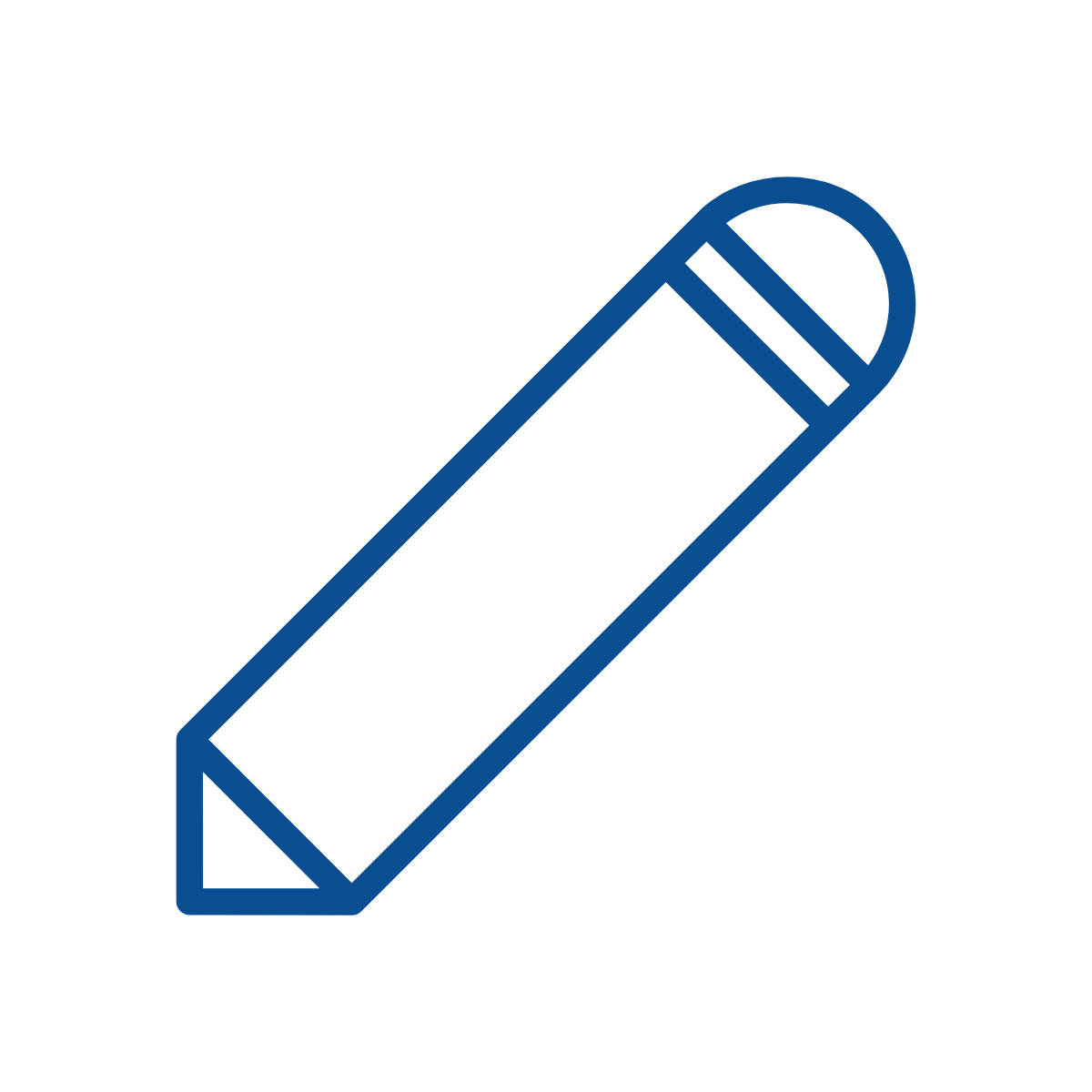Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Chloé Branders - Financer un doctorat et un postdoctorat en criminologie
Réaliser une recherche doctorale et postdoctorale reflète un long parcours marqué par de nombreuses satisfactions, voire des moments de bonheur. Cependant, et même si on en parle que très rarement, chaque réussite est aussi marquée par des rejets, comme ceux liés aux demandes de financement.

Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours académique et tes principaux thèmes de recherche des dernières années?
Comme pour de nombreuses personnes qui s’engagent dans la carrière académique, mon chemin a été long, enrichissant, parsemé de belles réussites, bien sûr, mais également de nombreuses épreuves.
J’ai réalisé ma thèse de doctorat en criminologie au Centre de recherche Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité (CRID&P) de l’UCLouvain. J’ai bénéficié d’un financement FNRS entre 2014 et 2018 mais je n’ai finalement défendu qu’en 2020. J’ai terminé mon doctorat sur un mandat d’assistant d’enseignement. En 2018, ma première fille est née et cela a constitué une immense joie et une difficulté supplémentaire pour terminer ma thèse. J’ai finalement défendu ma thèse en privé un peu avant le début du premier confinement et ma défense publique a d’abord été reportée puis s’est finalement tenue en distancielle. J’ai été une des premières personnes à défendre sa thèse de doctorat en distancielle, à l’UCLouvain, durant la période covid. Je garde comme souvenir de cette défense un moment très joyeux malgré le contexte exceptionnel.
Ma thèse portait sur l’action culturelle en détention et j’y ai développé une épistémologie spécifique, proche de ce qu’on pourrait appeler la recherche création. En criminologie, on a une grande tradition ethnographique et j’ai fait beaucoup d’observation participante en prison et aussi en Institution Publique de Protection de la jeunesse (IPPJ), pour accompagner des animatrices et animateurs qui coordonnaient des ateliers artistiques. Mon intérêt s’est porté sur le théâtre et cela m’a amené à analyser les rôles sociaux et explorer comment ce type d’activité permet de créer du commun, de construire du propos politiques et de bousculer les interactions sociales institutionnalisées dans les lieux d’enfermement investis.
Une fois ma thèse défendue, on m’a offert un travail d’éditrice pour lancer une nouvelle revue d’analyse sociopolitique de pratiques culturelles au Centre du Théâtre Action. J’ai ainsi lancé la revue impACT et j’y ai travaillé 4 ans à temps partiel. Cela m’a permis en parallèle de prendre plusieurs charges d’enseignement dans plusieurs universités (UCLouvain, Université catholique de Lille, ULB).
En 2021, ma deuxième fille est née. Et en 2023, j’ai embarqué toute ma petite famille pour réaliser un séjour de recherche à l’Université du Michigan auprès du Prison Creative Arts Project. Un des plus importants programmes au monde proposant des ateliers culturels en détention. C’était une expérience très riche. Au même moment, mon ouvrage, Théâtre en réclusion. Du jeu à la subversion, parait chez Larcier Intersentia.
En janvier 2024, je dépose un projet de recherche pour le mandat de Chargée de recherches FNRS (CR) et je l’obtiens. Je commence alors comme chargée de recherches, en octobre 2024 au CRPS&D. La même année, je postule à la Chaire ouverte en criminologie, pour laquelle, je suis retenue. J’ai ainsi commencé cette rentrée comme professeure à l’École des sciences criminologiques Léon Cornil.
Mon post doctorat FNRS a marqué un tournant dans mes intérêts de recherche. M’appuyant sur une conceptualisation de la subversion des rationalités dominantes développée durant ma thèse de doctorat et les premières années qui ont suivi, j’ai voulu appliquer mon cadre théorique non plus simplement aux rationalités pénales et sécuritaires propres aux lieux d’enfermement mais également aux grandes normativités de genre, de race et de classe qui traversent et structurent ces institutions. Ainsi, mes recherches actuelles portent plus spécifiquement sur la justice des mineurs au prisme du genre et de l’intersectionnalité. Ainsi, je m’intéresse à l’expression des masculinités en IPPJ et aussi, aux manières de défaire les rationalités dominantes qui les soutiennent. Parallèlement, je m’intéresse aux rôles des sœurs, proches des personnes enfermées et qui vivent une « expérience carcérale élargie », comme le dit Caroline Touraut.
As-tu obtenu des financements pour réaliser tes recherches ?
Donc outre mes deux financements FNRS (FRESH, pour mon doctorat sous la direction de Dan Kaminski et Chargée de Recherches (CR), pour mon post doctorat sous la direction de Jérôme Englebert), j’ai obtenu la bourse d’excellence du WBI (Wallonie-Bruxelles international), me permettant de financer en partie mon séjour de recherche aux États-Unis.
L’appel « Chargé·e de recherche FNRS » va bientôt s’ouvrir. Pourrais-tu nous parler de ton expérience ?
La construction du projet est exigeante. Il s’agit de produire un document synthétique qui est nécessairement dense mais qui doit rester très clair et lisible. C’est un concours très compétitif, auquel on peut postuler jusqu’à trois fois. Rares sont les personnes qui l’obtiennent à la première tentative. Il faut persévérer. A l’issue de l’évaluation des projets déposés, les noms des lauréat·es sont affiché en ligne, sur leur site. Quelques semaines plus tard, chaque personne ayant déposé un projet obtient un rapport écrit détaillant l’évaluation qualitative du projet et du profil du chercheur ou de la chercheuse candidat·e, par trois experts anonymes désignés par la commission. Je trouve que ce rapport est particulièrement instructif pour des jeunes chercheur·euses car il fait comme une photographie du parcours de la candidate ou du candidat, permettant de visualiser les points forts et les points à améliorer du CV.
Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui souhaitent postuler ?
Je conseille de s’y prendre bien à temps afin de déposer un projet qui aura bénéficié de plusieurs relectures. S’appuyer sur l’expérience d’autres personnes qui ont obtenu le financement et bien évidemment, de l’appui de logisticien·ne·s de recherche est très précieux.
L’idée est de construire un projet dans la continuité de ses recherches antérieures (continuité) et aussi en rupture (évolution). L’originalité du projet est très importante, ainsi que l’originalité, la cohérence et la pertinence des méthodologies de recherche proposées. L’autre élément primordial est le profil du candidat ou de la candidate qui doit pouvoir démontrer d’une excellence scientifique à travers les publications, l’obtention de prix, etc. Mais mon évaluation a également démontré qu’un ancrage important sur le terrain peut être valorisé.
De manière générale, les années postdoctorales sont difficiles, parsemées de moments d’inactivité sans pourtant jamais cesser de travailler (publications, candidatures…), de remplacements et de contrats à courtes durées souvent précaires et de candidatures qui sont des épreuves très énergivores et émotionnellement souvent éprouvantes. Donc mon conseil principal est de persévérer, bien s’entourer et tant que faire se peut trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée et sociale, favorisant la santé mentale qui est rudement mise à l’épreuve durant ces années. Je pense aussi qu’une planification par priorisation permet de suivre une trame claire et éviter l’éparpillement qui est un des grands écueils de cette période.
Pourquoi cet appel est important ?
J’ai déjà mentionné l’intérêt d’avoir une évaluation sous forme d’un rapport écrit issu d’une triple évaluation par des personnes expertes de la commission permettant de faire son autoévaluation et aussi d’améliorer le cas échéant son projet afin de le redéposer.
Par ailleurs, obtenir un financement CR FNRS est également un excellent tremplin pour ensuite pouvoir postuler comme Chercheur·euse qualifié·e.
En cas de ne pas avoir ce financement, quelles autres sources recommanderais-tu ?
Au FNRS, il est également possible de construire un Projet De Recherche (PDR) interuniversitaire qui permet de financer un·e post-doctorant·e plutôt à temps partiel. D’autres financements sont aussi à explorer notamment chez Innoviris et dans le domaine de la criminologie, l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) est bien sûr incontournable. La créativité est à cultiver pour trouver d’autres options, encore.