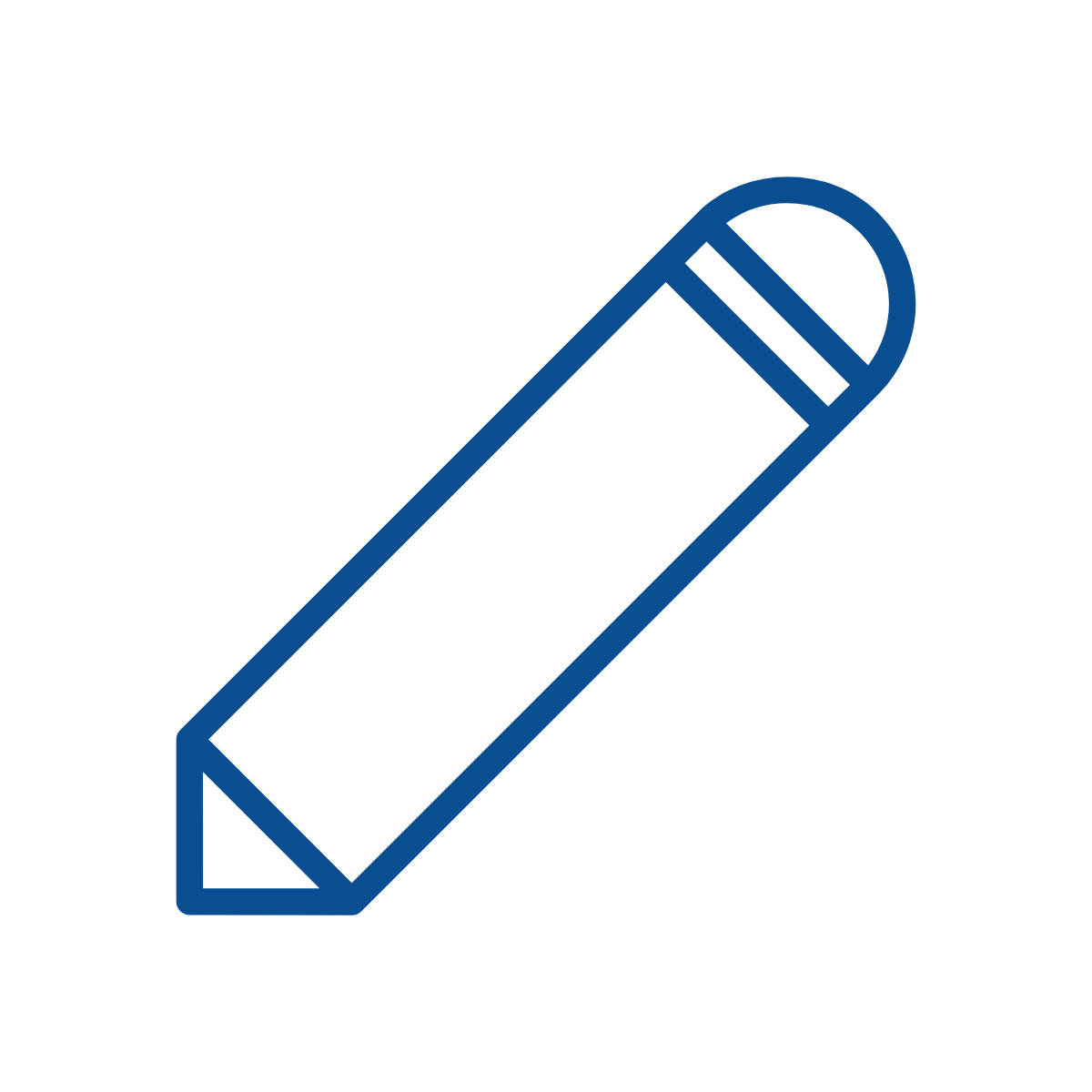Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Marie Beudels - Quelques défis pour diffuser une recherche vers un large public
La diffusion fait partie de la recherche scientifique. Cependant, certaines peuvent être plus compliquées à diffuser vers un large public, en raison notamment de l’aspect technique de la thématique. Pourtant, il existe des mécanismes au sein de l’université pour accompagner les chercheur·euse·s, aussi en fin de thèse de doctorat. Marie Beudels, doctorante au Centre de droit public et social de la Faculté nous parle de sa recherche, de quelques défis liés à sa diffusion et de sa récente expérience au concours Ma thèse en 180 secondes.
Marie, pourrais-tu nous parler de ta recherche doctorale?
Ma thèse porte sur une composante de la facture d’électricité que nous payons tous et qui s’appelle les tarifs de réseau d’électricité. J’ai donc l’avantage de travailler sur un sujet qui nous touche, a priori, tous, mais qui n’est malheureusement pas quelque chose qu’on apprécie nécessairement. Il y a aussi beaucoup de complexité autour de cette facture d’électricité et du secteur énergétique de manière générale. J’ai donc tendance à commencer mes interventions en donnant des informations de contexte relatives à la facture d’électricité, au marché de l’électricité ou à l’impact de la transition énergétique sur les réseaux électriques
Selon ton expérience, quels sont les deux principaux défis rencontrés quant à la diffusion de la recherche avec le grand public ?
Tout d’abord, je pense qu’il est compliqué d’arriver à trouver un point d’entrée dans notre recherche. Que ça soit une analogie, une mise en abime, un exemple, etc. il est important de rapidement attirer l’attention de l’audience. Mais quand on a une recherche un peu technique comme la mienne, on pourrait être tenté de vouloir donner des informations de contexte avant d’entrer dans le contenu même de la recherche.
Ensuite, il faut trouver un bon équilibre entre être précis et être clair. Parfois, à vouloir trop donner de détail parce qu’on sait qu’il y a de la nuance dans ce qu’on veut dire – ça reste quand même la présentation d’un travail de thèse qui a pris plusieurs années –, on perd l’auditeur. A contrario, si on reste trop généraliste, on ne permet pas à l’audience de réellement comprendre l’apport de notre recherche. Il faut donc trouver le bon équilibre et arriver à informer le public sans entrer dans des élucubrations.
Tu as récemment participé à Ma thèse en 180 secondes (MT 180). Pourrais-tu nous expliquer ce qu’est MT180 ?
« Ma thèse en 180 secondes » est un concours de vulgarisation scientifique. Les participant·e·s, des doctorant·e·s ou des docteur·e·s récemment diplômé·e·s, ont trois minutes, chrono en main, pour présenter leur recherche de façon claire et convaincante, le tout avec l’appui d’une seule diapositive.
Quel a été le principal défi pour parler de ton thème de thèse durant ce concours?
Le défi a été d’arriver à construire un texte qui rentre bien plus directement dans le vif du sujet et dans l’apport d’une recherche juridique sur ces questions plutôt technico-économiques. Il a aussi fallu apporter un peu d’humour et de légèreté pour parler de ce sujet qui pourrait rappeler de mauvais souvenirs aux personnes qui ont vu leur facture d’énergie exploser pendant la crise énergétique. J’ai par exemple pu mentionner que ma recherche commence à partir d’une directive européenne adoptée le jour de ma naissance, ce qui fait toujours un peu mouche.
Ensuite, il a le défi de la gestion du stress et du temps le jour J. Ça reste une prestation devant un public et c’est un exercice un peu intimidant. Mais par contre, ici on n’a que 180 secondes chrono en main, et si on excède le temps, on est disqualifié. Il faut gérer son stress pour s’assurer une bonne question du timing. Ici, le coaching que nous avons reçu m’a vraiment beaucoup aidée à rester à l’aise et concentrée et je vais garder longtemps en tête les conseils que nous avons reçus à ce sujet !
Pourquoi as-tu souhaité y participer ? Quelles étaient tes attentes ?
J’ai toujours bien aimé les prises de parole en public, mais dans les conférences juridiques, on a souvent droit à 20 minutes d’exposé, ce qui est assez long. Je participais donc au concours surtout pour le défi d’arriver à présenter sa recherche en seulement trois minutes. Trois minutes, c’est court… et pourtant c’est déjà assez pour perdre l’attention du public. Le défi était donc d’arriver à construire un texte intéressant pour un public curieux, mais non initié, et quand même relativement précis quant au contenu de ma recherche. C’est donc surtout le processus de création de texte qui m’intéressait et l’accompagnement que l’ULB offrait dans le contexte du concours.
Ma thèse en 180 secondes poursuit deux objectifs principaux :
- Informer le grand public de la richesse et de l’intérêt des recherches scientifiques
- Développer les compétences communicationnelles des doctorant·e·s avec le grand public.
Quels ont été les principaux apprentissages à ces deux niveaux ?
Je pense que les apprentissages du concours portent surtout sur la vulgarisation de notre recherche au grand public. Cela dit, les séances de coachings se font en groupe avec d’autres participants. Ces autres doctorant·e·s sont certes nos concurrents, mais aussi nos premiers auditeurs, et de réels coachs qui nous aident à améliorer notre texte, en plus, bien évidemment du soutien offert par les coachs externes. Dans mon cas, il y avait dans mon groupe une psychologue, un économiste, une politiste et une scientifique travaillant sur le cancer. Bref, un groupe avec des centres d’intérêt très larges. Et je pense que c’est ce travail en groupes très variés qui permet d’améliorer la qualité de nos textes et, en fin de compte, de notre prestation sur scène et de notre capacité à naviguer l’audience dans notre recherche.
Quelques informations complémentaires
- Marie Beudels, sur le site du Centre de droit public et social de l'ULB
- Sur le concours Ma thèse en 180 secondes à l’ULB: https://www.ulb.be/fr/doctorat/ma-these-en-180-secondes. La finale nationale aurait lieu le 21 mai 2025 à Mons: https://mt180.be/
Mis à jour le 25 avril 2025